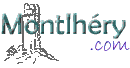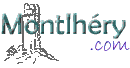Le château de Montlhéry (7)
SOMMAIRE

LA MOTTE FEODALE
Description
Une motte a été identifiée sur le site de Montlhéry à proximité
du château actuel et en retrait du village. Elle se situe à mi-pente
de la colline qui porte le château.
Des fouilles ont été réalisées par l'association locale des "amis
du château féodal de Montlhéry" de 1980 à 1982. Ces fouilles
ont permis de préciser la nature de cet ensemble.
La motte apparaît, maintenant, complètement envahie par la végétation.
Elle est partiellement effondrée et ravinée mais on reconnaît sa
forme générale.
Elle se présente sous l'aspect d'un polygone ovalisé de trente
mètres sur vingt-cinq mètres au sol avec une plate-forme sommitale
d'environ dix mètres de diamètre située à environ sept mètres de
hauteur.
Selon les observations de Monsieur Payen, président de l'association
: "il est possible de distinguer, du sommet de la motte vers
le nord-est, ce qui fut sa basse-cour d'où furent levées les terres"
'
L'étude de résistivité effectuée en 1980 sur la partie occidentale
de la plate-forme et le versant de la motte correspondant prouva
la présence d'une construction en pierre enfouie. Une intervention
similaire menée sur le versant Sud, dans la ravine qui s'y trouve,
a permis la découverte d'une muraille en pierres meulières liées
par un mortier. Cette étude a été complétée en 1981 par la découverte
sous les pentes Est et Ouest d'un mur de pierres sèches orienté
Est-Ouest présentant des sortes de gradins. Ces découvertes posent
le problème de l'identification de ces structures et de la fonction
de la motte.
Analyse
Nous demeurons ignorants de l'aspect du château de Montlhéry aux
temps de Thibaud File-Etoupe et de Louis VI car la forteresse actuelle
date seulement du règne de Philippe II.
Plusieurs historiens, comme André Chatelain et Victor-Adolphe Malte-Brun,
tentèrent d'identifier la fonction de la motte de Montlhéry.
Déjà, l'hypothèse de la construction de cette motte durant la bataille
de Montlhéry en l465, est à exclure, car l'édifice est mentionné
dans des actes antérieurs à cet engagement.
Une seconde hypothèse a remporté les suffrages : il s'agirait vraisemblablement
du premier ensemble fortifié. En 1850, André Duchalais dans son
"mémoire archéologique sur la tour de Montlhéry" est le
premier à l'affirmer. Il fonda son raisonnement sur la lecture de
"la geste de Louis VI" de l'abbé Suger. Un passage décrit
la fuite de l'armée des frères Garlande, qui assiégeaient la tour
de Montlhéry, à la vue de l'ost, de Guy de Rochefort. Suger rapporte
que l'armée des frères Garlande s'était déployée sur le sommet de
la colline (où se trouve le château actuel), la motte devait logiquement
être disposée à mi-pente, comme l'est actuellement la motte de Montlhéry.
Cet emplacement à mi-pente n'est pas rare pour une motte castrale,
20% des châteaux-forts de l'Ile-de-France construits du Xème au
XIIIème siècle étaient établis ainsi. Victor-Adolphe Malte-Brun
est le second auteur à diffuser cette idée, mais il n'avance aucune
preuve décisive. 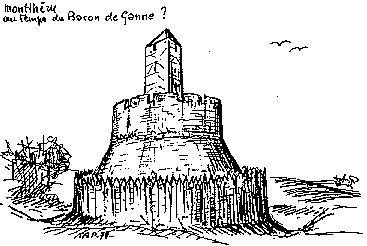 André
Chatelain ne croit pas que la motte de Montlhéry corresponde à la
place forte décrite par l'abbé Suger dans sa "geste de Louis
VI", il pense que celle-ci était située sur le site de la forteresse
actuelle. Mais André Chatelain fait une erreur. Il avance que la
motte devait être implantée sur le sommet du piton gréseux, ce qui
ne correspond pas au texte de Suger qui précise bien que les hauteurs
étaient occupées par les assiégeants. Lors des fouilles, la découverte
de structures enfouies sous le monticule prouve l'existence d'un
édifice construit à son sommet. Le mur Est-Ouest de pierres sèches,
offrant un dispositif en escalier, servait de mur de soutènement
aux terres rapportées. Au sommet se dressait probablement une tour
de bois ; les murs retrouvés lors de la fouille étant manifestement
des solins de pierre. André
Chatelain ne croit pas que la motte de Montlhéry corresponde à la
place forte décrite par l'abbé Suger dans sa "geste de Louis
VI", il pense que celle-ci était située sur le site de la forteresse
actuelle. Mais André Chatelain fait une erreur. Il avance que la
motte devait être implantée sur le sommet du piton gréseux, ce qui
ne correspond pas au texte de Suger qui précise bien que les hauteurs
étaient occupées par les assiégeants. Lors des fouilles, la découverte
de structures enfouies sous le monticule prouve l'existence d'un
édifice construit à son sommet. Le mur Est-Ouest de pierres sèches,
offrant un dispositif en escalier, servait de mur de soutènement
aux terres rapportées. Au sommet se dressait probablement une tour
de bois ; les murs retrouvés lors de la fouille étant manifestement
des solins de pierre.
Le texte de Suger parle d'une chemise entourant la tour mais pas
de vaste basse-cour, cas habituel des textes dans lesquelles les
basses-cours ne sont jamais mentionnées. Gabriel Fournier déclare
que les châteaux au XIIème siècle ont tendance à rétrécir et à renoncer
aux enceintes trop vastes héritées de l'époque précédente. tel semble
être le cas à Montlhéry.
Conclusion
Avec la lecture de "la geste de Louis VI" de l'abbé Suger
et des rapports de fouilles de "l'association des amis du château
féodal de Montlhéry", il ne fait aucun doute que la motte de
Montlhéry soit bien le site de la forteresse décrite par l'abbé
Suger.
Alors selon la classification de Jean Mesqui dans son livre "Châteaux
et enceintes de la France médiévale, tome I" la motte de Montlhéry
appartient à la famille de la motte à tour dotée d'une enceinte
ou chemise. Dans la plupart des cas, cette chemise est tellement
proche de la tour qu'il est impossible d'édifier des bâtiments entre
eux ; la motte de Montlhéry en est un parfait exemple.
De plus le texte de Suger explique la fonction de chaque élément
la chemise joue un rôle défensif et la tour un rôle de refuge pour
les nobles assiégés.
L'histoire du démantèlement de cette fortification est connue par
Suger. Louis VI en 1105 détruisit toutes les fortifications du château,
à l'exception de la tour. L'histoire de ladite tour reste inconnue
après 1105.
|