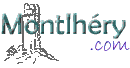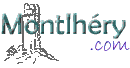Montlhéry sous Henri IV, d'après Claude Chastillon (7)
Par Jeannine GAUGUÉ-BOURDU - Bulletin monumental 1981
Introduction
Historique
Commentaire ponctuel des gravures
Commentaires centrés sur la gravure
22
Commentaires centrés sur les gravures
jumelées
Problème des proportions
Conclusion
Références

Conclusion
La fiabilité de C. Chastillon, à quelques conventions près,
a été, il semble, démontrée. Les notations
qui apparaissent déconcertantes à première vue, tel
que le rabattement de la courtine sud ou de dédoublement de la chapelle
Saint-Louis ont pu être expliquées par une analyse attentive
et démontrent le souci de précision du dessinateur. Cette
précision est moindre dans la représentation des églises
aux clochers conventionnels (Sainte Trinité) ou purement imaginés
(Saint-Pierre Saint-Laurent).
|
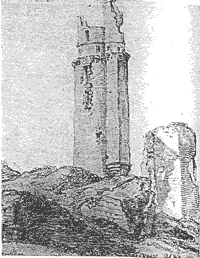
Fig. 14 - Dessin des ruines du château
de Montlhéry par A. Wille, XIXe siècle, coll. Destailleur.
|
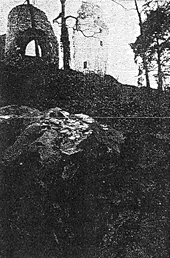
Fig. 15 - Photographie montrant le
socle de grès sur lequel est bâti le château de Montlhéry.
|
La gravure de Chastillon est beaucoup plus rigoureuse, dans ses détails,
que la représentation de De La Pointe sans évoquer les nombreux
dessins, gravures et aquarelles que la ruine de Montlhéry a inspirées
à l'époque romantique (40) (fig.
14). La représentation de Chastillon soutient la comparaison
avec celle de Gaignières datée de 1704.
Etrangères à tout pittoresque, à toute fantaisie
et à tout souci artistique, pourrait-on dire, les gravures de Chastillon
se caractérisent par un dessin sec et précis et reflètent
la double personnalité de leur auteur (41).
L'intérêt du topographe est souligné par la présentation
du château bien campé dans son site. Le bien rendu du socle
de grès (fig.
15), encore apparent actuellement par endroits, malgré les ajouts
de terre arable et la croissance de la végétation, est caractéristique
à cet égard.
La spécificité de l'ingénieur militaire est indiquée
par la volonté délibérée de restituer, fût-ce
à l'aide d'artifices, la réalité de la forteresse
; d'en désigner les principaux éléments par des lettres
repères, d'en noter les accès (H et E) et de
rappeler son passé récent en faisant figurer, suivant les
conventions du temps que l'on observe, par exemple, au plan du siège
de Paris de Pigafette, une troupe en marche.
La forteresse de Montlhéry et son site stratégique ont
intéressé les rois de France (et leurs ennemis) depuis ses
origines. Son importance s'était manifestée également
au cours des guerres de religion. Peut on voir dans les gravures de Claude
Chastillon le désir d'Henri IV de matérialiser le sort de
la résistance au pouvoir royal ?
Il est difficile d'être très précis quant à
la date de la " commande ". Lebeuf parle de 1610
(42), Malte-Brun de 1604 (43). Aucun n'avance de sources ni d'arguments.
La végétation sauvage qui s'est implantée sur les
parties ruinées donnerait à penser que dix à quinze
ans se sont écoulés depuis le démantèlement
de 1591.
A. L. Millin (44) écrit à propos des illustrations de Montlhéry
: " C. Chastillon l'a aussi figuré dans sa topographie
en 1610. Ces figures sont détestables et absoluments idéales
". L'analyse minutieuse de ces vues permet de rejeter ce jugement
sévère. Bien au contraire, elle souligne la volonté
de Chastillon de rendre aussi fidèlement que possible la physionomie
complète des lieux comme il le fait le plus souvent. La valeur documentaire
certaine des gravures de la Topographie française est renforcée
par l'importance historique des dessins du " reporter officiel
" du roi Henri IV.
<< Précédent
Suite
>>
|